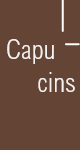Capucins - un Ordre franciscain
Les capucins sont la dernière réforme au sein de l’Ordre franciscain. Leur nom vient de la capuche qui protégeait efficacement les frères en route qui, à partir de 1525, quittèrent les grands couvents franciscains pour renouer résolument avec la vie érémitique et itinérante de François. Outre la branche des capucins, qui compte aujourd’hui environ 10’000 frères, les Cordeliers (conventuels) à l’habit noir, plus urbains, et les franciscains, fusion de toutes les autres branches en 1897 (habit brun), remontent également à François.
Depuis les débuts
Au début de l’été 1216, le chanoine français Jacques de Vitry traverse les Alpes pour se rendre à Pérouse. Il y séjourne quelques semaines à la cour pontificale, dont la vie le dégoûte. Dans son récit de voyage de l’automne, l’évêque nouvellement ordonné est le premier à décrire le mouvement encore jeune autour de François d’Assise :
 « En ces régions (l’Ombrie), j’ai cependant trouvé une consolation, car beaucoup de riches et de séculiers des deux sexes, ayant tout abandonné pour le Christ, fuyaient le monde : on les appelait « frères mineurs » et « sœurs mineures ». Le seigneur pape et les cardinaux les tiennent en grande révérence ; ceux-ci ne s’occupent nullement des affaires temporelles, mais, avec un désir fervent et un zèle ardent, ils travaillent chaque jour à arracher aux vanités du monde les âmes en péril et à les conduire avec eux… Ils vivent selon la forme de l’Église primitive… De jour, ils se rendent dans les cités et les villages en œuvrant par l’action afin de gagner quelques-uns ; la nuit, ils regagnent leurs ermitages ou des lieux solitaires pour s’adonner à la contemplation. … Une fois l’an, les frères de cette religion se réunissent avec grand profit en un endroit convenu pour se réjouir dans le Seigneur et manger ensemble… Je suis persuadé que c’est pour faire honte aux prélats, qui sont comme des chiens muets, incapables d’aboyer, que le Seigneur veut sauver de nombreuses âmes par de tels hommes simples et pauvres avant la fin du monde. »
« En ces régions (l’Ombrie), j’ai cependant trouvé une consolation, car beaucoup de riches et de séculiers des deux sexes, ayant tout abandonné pour le Christ, fuyaient le monde : on les appelait « frères mineurs » et « sœurs mineures ». Le seigneur pape et les cardinaux les tiennent en grande révérence ; ceux-ci ne s’occupent nullement des affaires temporelles, mais, avec un désir fervent et un zèle ardent, ils travaillent chaque jour à arracher aux vanités du monde les âmes en péril et à les conduire avec eux… Ils vivent selon la forme de l’Église primitive… De jour, ils se rendent dans les cités et les villages en œuvrant par l’action afin de gagner quelques-uns ; la nuit, ils regagnent leurs ermitages ou des lieux solitaires pour s’adonner à la contemplation. … Une fois l’an, les frères de cette religion se réunissent avec grand profit en un endroit convenu pour se réjouir dans le Seigneur et manger ensemble… Je suis persuadé que c’est pour faire honte aux prélats, qui sont comme des chiens muets, incapables d’aboyer, que le Seigneur veut sauver de nombreuses âmes par de tels hommes simples et pauvres avant la fin du monde. »
Le « petit frère d’Assise » a trouvé un chemin particulier vers une vie plus intense – personnellement et avec d’autres. Son humanité se distinguait par sa « profondeur et son étendue » : Une vie ancrée dans la terre – en tant que créature dans un monde commun, qui se révèle être une famille universelle, créée avec art par la volonté libre été aimante de Dieu. La terre devient un espace vital que les plantes, les animaux et les hommes partagent en réseau. Une vie intégrée dans une société humaine aspire à une liberté de plénitude mais l’est souvent faite au détriment des autres : pour s. François, seule l’interaction sensible de tous les hommes lui apporte également la paix. François, en tant que commerçant, cherche d’abord le profit et le plaisir, ses projets ambitieux de devenir chevalier sont un échec. Il cherche finalement Celui qui est plus que tout. François trouve sa vie épanouissante progressivement – inspiré par un Celui qui est au-dessus de tout, vers lequel tout pointe et qui a en même temps laissé ses propres traces dans notre monde. En suivant la vie et l’humanité de Jésus de Nazareth, François s’étonne du simple rapport de Dieu avec nous, Lui qui s’est fait homme avec son corps et son âme et qui reste dans le monde « tous les jours jusqu’à la fin » : audible dans les évangiles, visible et précieux dans le pain partagé de l’autel, présent aussi au milieu des plus pauvres. La présence silencieuse de Dieu en chaque être humain, son inhabitation en nous, il la trouve chez des personnes inspirées et aussi dans d’autres religions, et il donne de nombreux noms féminins à cette force, cette sagesse et cet amour de Dieu au plus profond de lui-même.
Le mouvement du Poverello regroupait déjà de son vivant des personnes de toutes conditions, professions et modes de vie, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Église. François a affirmé cette Église tout comme il a osé emprunter un tout nouveau chemin en son sein. Son art de lier mystique et politique, d’exploiter la richesse intérieure de la tradition et de la communauté élargie tout en faisant confiance à l’inspiration de chacun, permet au mouvement franciscain d’innover à chaque époque sur le plan ecclésial, social et politique.